Entretien avec Claudia Jane Scroccaro
Dans votre parcours, on constate que nombre de vos enseignements vous ont été donnés par des compositeurs hommes. Pouvez-vous nous parler de votre vécu en tant femme, étudiante puis compositrice ?
Claudia Jane Scroccaro : Pour devenir compositeur ou compositrice, il est d’usage de commencer par une formation instrumentale. Dans mon cas, c’était le piano. J’étais très jeune quand j’ai commencé à étudier la direction d’orchestre et c’était un métier où il y avait assez peu de femmes. Beaucoup de mes enseignants et de mes homologues étaient certes des hommes, mais la présence d’une étudiante femme n’était pas non plus une nouveauté pour tous, donc je n’ai pas ressenti que mon genre était particulièrement un problème. En contexte académique, on est en quelque sorte « protégé.e.s » de par la hiérarchie établie entre enseignant.e et étudiant.e.s.  Chacun a son rôle, et je n’ai pour ma part pas trop souffert de discriminations, même si je sais que cela n’a pas été le cas pour beaucoup d’autres femmes. Cela s’est compliqué lorsque j’ai dû revêtir la tenue de cheffe d’orchestre, car ce rôle implique de prendre la direction d’un grand groupe de personnes. En contexte professionnel, les dynamiques évoluent, et c’est une transition très compliquée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, du fait aussi d’une forte compétition.
Chacun a son rôle, et je n’ai pour ma part pas trop souffert de discriminations, même si je sais que cela n’a pas été le cas pour beaucoup d’autres femmes. Cela s’est compliqué lorsque j’ai dû revêtir la tenue de cheffe d’orchestre, car ce rôle implique de prendre la direction d’un grand groupe de personnes. En contexte professionnel, les dynamiques évoluent, et c’est une transition très compliquée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, du fait aussi d’une forte compétition.
J’ai vécu plus de discriminations quand je me suis orientée vers la composition électronique. Je savais que c’était mon domaine de prédilection, mais j’ai dû quitter le cursus dédié au Conservatoire de Rome parce qu’on me faisait ressentir que n’y étais pas « légitime ». Dans ce type de formation, il y a beaucoup de technique, de travail de plateau, il faut avoir de la force physique aussi. Par conséquent, la présence d’une femme est perçue comme quelque chose d’exceptionnel. Je me souviens d’une fois où, avec ma classe, nous avions eu l’occasion de participer à l’organisation d’un festival de musique électronique. C'était intéressant car cela nous permettait de nous professionnaliser au travers de la mise en place de projets concrets. Mais le problème, c'est que toutes les étudiantes femmes, c’est-à-dire 3 personnes sur 10, se sont retrouvées dans des rôles de secrétaire. Quand j’ai enfin eu la possibilité de m'impliquer d’un point de vue artistique, j'ai reçu des remarques de la part de certains directeurs artistiques et professeurs, au sujet de « mon caractère ». On critiquait ma personnalité plutôt que mon travail, ce qui n’arrivait jamais à mes homologues masculins. Il y a une sorte de légitimité à faire ce genre de remarques aux femmes. C’était il y a seulement 10 ans, donc il n’y a pas si longtemps, même si je pense que, selon les pays, la façon dont sont traitées les femmes change beaucoup.
Ce témoignage est assez représentatif des stéréotypes de genre associés aux femmes !
C.J.S. : Sauf que comme j’étais convaincue d’avoir trouvé ma voie, j’ai refusé de me laisser gâcher ces moments très importants de ma carrière. J’ai donc quitté l’Italie pour aller suivre les cours de Marco Stroppa en Allemagne. La répartition hommes/femmes y fluctuait complètement d’une année à l’autre, et avec lui, j’ai vraiment eu l’impression que le genre importait peu, que c’était uniquement une question de compétences. En tant qu’enseignante, c’est quelque chose que j’essaye d’appliquer à mon tour. Parler de division homme/femme est d’ailleurs assez réducteur aujourd’hui, car il faut aussi prendre en compte les personnes non binaires. Mais le manque de femmes dans l’informatique, notamment musicale, reste un réel problème : bien que cela ne soit pas explicitement dit, il y a des attentes particulières envers les femmes. En tant que femme, je sens que je n’ai pas le droit à l’erreur, car si j’en fait, cela va malheureusement aller valider certains préjugés. Moi, je pense que le professionnalisme, c’est plutôt de savoir gérer ses erreurs ! À l’Ircam, je la première et la seule RIMCE (RIM chargé.e de l’enseignement), et je ne tiens pas à être la dernière !
Qu’est-ce qui a été fait au sein du Cursus pour essayer d’améliorer la parité ?
C.J.S. : La première fois que j’ai fait partie d’un jury pour sélectionner les candidat.e.s au Cursus, je me suis vite rendu compte qu’il n’y avait pas assez de candidates femmes. Dans ce contexte-là, comment peut-on respecter la parité ? En imposant des quotas, on risquait de ne pas rendre service à certaines compositrices qui n’ont peut-être pas encore la maturité requise. Ce que l’on a décidé de mettre en place, c'est notamment de changer certains critères de recrutement et de rendre le texte de l’appel à candidatures plus inclusif. N’ayant moi-même pas suivi un parcours d’études linéaire, parce devenir compositrice – surtout de musique électronique – est long et difficile, je pense qu’il faut laisser le temps aux artistes de se former. On a tendance à avoir des profils plus intéressants, de manière générale, avec des candidat.e.s plus âgé.e.s. Je connais aussi beaucoup de femmes qui débutent tard leur carrière, par peur d’échouer ou à cause d’un sentiment d’illégitimité. Moi-même, j’avais attendu le dernier moment pour candidater, c’était ma dernière chance ! Ce sont donc des premières mesures, un « work in progress » comme on dit, mais qui ouvre la porte au changement. Des efforts sont aussi menés par le département de la Pédagogie dans le recrutement des compositeur.rice.s intervenant.e.s, avec notamment la présence d’Eva Reiter pour le Cursus 2026/27. Je pense qu’il est essentiel que les équipes pédagogiques donnent une résonance à ces questions de parité.
Comment en êtes-vous arrivée à exercer en tant que RIMCE et quel est votre rôle ?
C.J.S. : En tant que RIMCE, mon rôle est différent des RIM. Les RIM accompagnent les compositeur.rice.s dans leurs projets et prennent en charge toute la partie électronique, tandis que les RIMCE, comme moi, sont des enseignant.e.s. qui accompagnent, dans le sens pédagogique du terme, la jeune composition. J’ai été recrutée parce que, venant d’achever le Cursus de l’Ircam, je connaissais bien tous les logiciels, et mon domaine de compétences, la composition assistée par ordinateur, était proche de celui de Mikhail Malt, mon prédécesseur. J’avais également enseigné pendant un an à Stuttgart avant de venir travailler à l’Ircam. 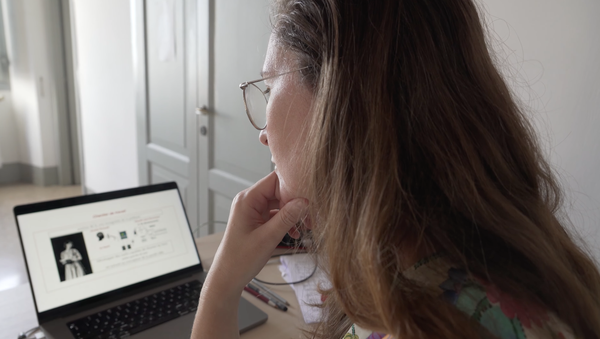 C’est donc allé très vite ; l’institut a décidé de me faire confiance alors que je ne me sentais pas parfaitement formée – un sentiment d'illégitimité qui est malheureusement très répandu chez les femmes ! Par ailleurs, j’ai un statut assez particulier, car non seulement j’enseigne mais je suis aussi une compositrice qui produit ses créations à l’Ircam. Cette double casquette peut être difficile à porter car, selon mon rôle – si j’agis en tant que collègue ou bien cheffe d’un projet –, je suis amenée à interagir différemment avec les mêmes personnes. Dans certains cas, cela peut compliquer les relations et ce n’est pas évident de savoir la cause du comportement de certain.e.s ; est-ce parce que je suis une femme ou bien à cause de ce changement de rôle ?
C’est donc allé très vite ; l’institut a décidé de me faire confiance alors que je ne me sentais pas parfaitement formée – un sentiment d'illégitimité qui est malheureusement très répandu chez les femmes ! Par ailleurs, j’ai un statut assez particulier, car non seulement j’enseigne mais je suis aussi une compositrice qui produit ses créations à l’Ircam. Cette double casquette peut être difficile à porter car, selon mon rôle – si j’agis en tant que collègue ou bien cheffe d’un projet –, je suis amenée à interagir différemment avec les mêmes personnes. Dans certains cas, cela peut compliquer les relations et ce n’est pas évident de savoir la cause du comportement de certain.e.s ; est-ce parce que je suis une femme ou bien à cause de ce changement de rôle ?
Durant ces 3 années où vous avez enseigné à l’Ircam, avez-vous constaté une évolution dans la façon dont les étudiant.e.s approchent la création musicale d’une promotion à l’autre ?
C.J.S. : Chaque promotion est totalement différente. C’est aussi une volonté du jury au moment des sélections. On essaye collectivement de se poser des questions sur ce que l’on cherche, c'est stimulant d'avoir chaque année des nouveaux défis. Ce que je constate chez la nouvelle génération de compositeur.rice.s , c’est qu’elle est bien plus exigeante en termes de musique électronique. C’est dû notamment aux changements d’habitudes ; aujourd’hui, on écoute plus de musique avec de l’électronique que purement acoustique. La conséquence négative, c’est qu’on s’attend à retrouver toujours le même type de sonorités et qu’on ne sait pas nécessairement détecter des éléments non « naturels » dans un son. Je pense que de n’être formé.e qu’au digital sans avoir de vraie expérience acoustique peut empêcher de développer son imagination, car on est dans l’attente de réponses plutôt que dans la projection. La plupart des outils informatiques pour la création musicale sont maintenant génératifs, et le rôle des compositeur.rice.s va être de travailler avec ce matériau.
Concernant l’approche musicale, je pense qu’elle dépend de nombreux facteurs – dont notre sensibilité individuelle – qui vont au-delà du genre, mais je n’ai pas forcément encore le recul nécessaire pour tout analyser. Ce que je constate surtout et que je trouve très positif, c’est un changement dans la dynamique enseignant.e.s/étudiant.e.s. On s’éloigne du mode d’enseignement très directif et on se dirige vers un mode plus collaboratif, où les étudiant.e.s apprennent beaucoup entre eux. Cela s’explique en partie par un accès plus facilité à l’information, ce qui fait que même des domaines aussi spécifiques que la musique électronique se démocratisent. Il arrive même parfois que des étudiant.e.s en sachent plus que nous sur certains sujets ! La question que l’on doit se poser en tant qu’enseignant.e.s, c’est quelle approche adopter face à ces évolutions. Il y a des pratiques à mettre en place afin d’encourager ces échanges, qui sont très bénéfiques, surtout en informatique, tout en parvenant à les canaliser. Ces changements de dynamique s’observent aussi dans la relation RIM/compositeur.rice, où les RIM deviennent plus que de simples assistant.e.s techniques. De véritables collaborations se créent, des échanges de visions artistiques, car finalement rien ne se résume qu’à la technique.
Un message plutôt positif donc, de voir qu’à tous les échelons, les dynamiques relationnelles évoluent. Plutôt que d’établir des quotas et des régulations, il s’agirait donc de favoriser l’égalité des chances ?
C.J.S. : C’est compliqué, car les problèmes de parité créent du ressentiment entre les genres, et je ne sais pas si enforcer des quotas est la bonne solution. Pour autant, il ne faut surtout pas fermer les yeux sur les comportements discriminants ! Certains professeurs de conservatoire refusent toujours d’intégrer des femmes ; ça, il faut le condamner. Mais il existe aussi le sexisme « banalisé » qui est plus difficile à identifier car plus insidieux. J’ai déjà souffert de « mansplaining », où des hommes m’expliquaient mon propre travail. Le problème c’est que ce ne sont pas forcément des personnes ouvertement misogynes, c’est plus internalisé que cela. Fatiguant à la longue !
Et en ce qui concerne le domaine de la formation supérieure, quelles seraient les mesures à prioriser afin de garantir une meilleure parité ?
C.J.S. : Idéalement, il faudrait avoir le même niveau d’exigence, peu importe le genre, le parcours ou l’expérience de l’étudiant.e, essayant de supprimer ses biais. Les mesures que nous avons prises sont une première étape, il faut maintenant attendre de voir leurs répercussions. Il n’y a malheureusement pas de stratégie ni de formule magique. Ouvrir un débat pour trouver des solutions, c’est déjà important. C’est un travail qui doit également être fait en dehors de l’Ircam. Comme je voyage beaucoup et ai l’occasion d’être invitée dans des conservatoires ou des master classes, j’en profite pour parler de nos formations autour de moi. Je me fais le porte-voix de ces réflexions et j'encourage les compositrices que je rencontre à se lancer dans leurs projets, et à postuler si elles hésitent. Parfois, c’est aussi simplement donner des clés, les guider vers certaines ressources...
Pour finir, quel message ou conseil souhaiteriez-vous adresser aux femmes qui aimeraient s’engager dans la composition musicale ?
C.J.S. : Pas facile ! Le conseil que je pourrais donner, c’est de bien vous entourer. Détournez-vous des personnes qui ne vous veulent pas du bien, et au contraire allez chercher celles qui vous soutiennent. Ignorer les personnes néfastes est d’autant plus difficile quand il y a une notion de hiérarchie, comme dans une relation enseignant.e/étudiant.e, ou chef.fe/assistant.e. Je pense néanmoins que cela ne se résume pas à des comportements machistes, et que cela peut venir de n’importe qui, homme ou femme. Il faut alors avoir le courage de se faire confiance, tout en faisant attention à différencier les remarques négatives de la critique constructive. J’ai arrêté depuis quelques temps de questionner mes compétences car je sais maintenant de quoi je suis capable. Si je m’étais arrêtée aux critiques qu’on m’a fait, je n’en serais pas là aujourd’hui. Alors si mon histoire, qui est assez positive, peut encourager des vocations, c’est une très bonne chose !
![]()
Claudia Jane Scroccaro est en résidence à la Villa Medici pour sa création FARO, qui sera jouée lors du festival ManiFeste. Cette pièce lui a été inspirée par la poète Amelia Rosselli, dont elle souhaite valoriser l’œuvre littéraire et intellectuelle, qui est pour la compositrice une source d’inspiration immense, un véritable « phare » (« faro » en italien) guidant son écriture.
Photo 1 : Claudia Jane Scroccaro
Photo 2 : Capture-écran, vidéo Claudia Jane Scroccaro - Pensionnaire de la Villa Médicis (2024-2025)



