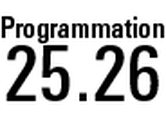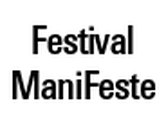« Poétiser le monde », comme le réclamait Novalis, c’est résister à des temps difficiles tout en maintenant ouverte la possibilité d’un réenchantement possible. Invité de ManiFeste 2020, Stefano Gervasoni est ce poète des sons.
Pour toute une génération de compositeurs qui commencèrent d’être actifs dans les années 1980, l’héritage immédiat, constitué de tendances et d’esthétiques contradictoires, imposait de faire des choix. Que Stefano Gervasoni, né en 1962, se soit tourné vers Luigi Nono au moment où s’affirma sa vocation de compositeur, puis vers Niccolo Castiglioni durant ses études académiques, avant de suivre les séminaires de composition de Helmut Lachenmann et de Brian Ferneyhough, doit moins nous inciter à inscrire sa démarche dans le sillage de l’une ou l’autre de ces personnalités qu’à signaler son inquiétude vis-à-vis du son dans ses dimensions aussi bien acoustique que sémantique. Au sein d’un mouvement qui avait provoqué le renversement des anciennes hiérarchies, ces compositeurs avaient en effet repensé, chacun à leur manière, la question du timbre en la reliant à des considérations éthiques, philosophiques et politiques. On retrouve celles-ci au fondement de la démarche du compositeur italien. L’extraordinaire invention sonore qui caractérise sa musique, et qui frappe d’emblée à son écoute, ne se présente pas comme une fin en soi, ou comme le résultat de spéculations théoriques, encore moins comme une sorte de maniérisme, mais comme une nécessité expressive, comme la recherche d’un langage ouvrant à d’autres possibles.
Pour cela, Gervasoni s’est tout d’abord concentré sur le phénomène sonore en soi, sur sa complexité et ses ambivalences, explorant l’intérieur du son à l’aide des différents modes de jeu, imaginant des alliages inédits, abolissant la frontière entre note et son ou entre son et bruit. À partir de cette « expérience empirique et immédiate » du matériau, pour reprendre les termes de Lachenmann, il a développé une syntaxe fondée sur la nature instable des phénomènes sonores que la tradition occidentale avait surmontée à travers l’organisation rationnelle des hauteurs. Il y a dans sa musique une palpitation du son, faite de tremblements, d’oscillations, de glissements, d’altérations qui affectent les notes comme les figures, qui renvoie aussi bien à une pensée du timbre menée jusqu’à ses conséquences ultimes qu’à une recherche expressive pour laquelle comptent les mouvements et les nuances les plus subtils. Il en résulte une musique à la fois fébrile et fragile, jamais grandiloquente. Son caractère introspectif apparaît dès les premières œuvres : Die Aussicht (1985, rév. 2003) sur l’ultime poème de Hölderlin lu à travers une analyse de Jakobson, Quattro Voci (1988) sur des poèmes de Sereni, Luzi, Sanguineti et Caproni, ou Least Bee sur des poèmes de Dickinson (1992). Il culmine dans son œuvre la plus autobiographique, Six Lettres sur l’obscurité (und zwei Nachrichten) pour quatuor à cordes (2005-2006). Le lyrisme contenu de ces œuvres ne renvoie pas seulement au moi profond du compositeur, mais s’étend à d’autres groupes humains et à tout ce qui vit dans la nature. Ainsi, dans Godspell (2002), les voix de la communauté noire américaine, étouffées, tentent de percer la texture instrumentale, sans parvenir toutefois à s’imposer. Dans descdesesasf (1995) et Atemseile (1997), rituels d’extinction, les voix muettes des victimes de la Shoah, à travers la présence elle-même muette d’un poème de Celan, posent l’angoissante question Warum ? (Pourquoi ?), empruntée à une pièce de Schumann. Les bribes diffuses d’un choral de Bach qui évoque la mort traversent de façon fantomatique Un leggero ritorno di cielo (2003).
Ces citations musicales, le plus souvent voilées, sont comme des signaux venus de loin ; ils brisent la tendance du langage à l’unicité, à la totalité. C’est pourquoi, dans Com que voz (2007/2009-2010), l’écriture contemporaine et la musique de fado se font face sans jamais fusionner. La distance n’est pas comblée. Aussi ces regards sur le passé, qui mettent en question les conceptions rigides d’une modernité refermée sur elle-même, n’ont-ils rien à voir avec une posture postmoderne. Ils nous rendent conscients des failles et des déchirures qui caractérisent notre époque, et que l’écriture exacerbe. C’est à partir d’une telle conscience critique que jaillissent des sonorités luminescentes, radieuses et magiques, des intervalles purs qui remontent le cours de l’histoire, ou ces suites d’accords parfaits enchaînés librement qui traversent Reconnaissance (2008) ou Dir - in dir (2003/2010), entre autres. Ces moments de transcendance, éphémères, surgissent au cœur des œuvres. Dans Antiterra (1999), qui fait signe vers Nabokov, ou dans Animato (1992), qui s’inspire de Ponge, les mouvements ascendants et les sonorités cristallines, qui polarisent la musique vers le registre aigu, visent de tels dépassements.

Ouvrir le son, en interroger les limites, lier l’historicité à l’inouï, et repenser les questions de l’écriture, du style, en lien avec le sens même de la musique : c’est ainsi que l’on pourrait résumer le travail de Gervasoni, dont la voix ne se confond avec nulle autre dans la création actuelle. Deux aspects qui font les grandes œuvres s’appliquent à sa musique : la beauté des combinaisons sonores, qui provient d’une intuition supérieure de l’affinité entre les sons et qui maintient la possibilité du merveilleux, sans quoi l’art s’aliène à lui-même, et la relation nécessaire entre les éléments de détail et la structure globale, qui résulte du travail d’écriture et renvoie à la probité du métier, à l’authenticité de la pensée.
Cette volonté de maintenir les contradictions vivantes tout en les inscrivant dans une rigueur compositionnelle sans faille débouche sur une conception fragmentée de la forme. Celle-ci ne renvoie ni à des schémas ni à des constructions architectoniques, mais exige d’être vécue dans son propre déroulement. Les différentes parties, centrées sur des figures qui tournent sur elles-mêmes tout en se transformant de façon imperceptible, sont le plus souvent articulées sans médiation, selon le principe du montage. Au temps presque immobile qui oriente l’écoute vers le cœur des processus, à travers la répétition variée, s’oppose le temps des ruptures, où l’on saute dans une autre dimension. La structure prismatique de la forme produit des perspectives multiples, soulignées par une rythmique souple et de constantes modifications de tempo. Elle ne laisse aucune place aux passages secondaires ou au remplissage, tout étant essentiel. Les différents moments, toutefois, ne sont pas interchangeables : ils s’inscrivent dans une trajectoire qui donne à l’œuvre son sens. Non qu’ils visent à une forme d’aboutissement ou d’apothéose, qui donnerait l’illusion de la positivité : ils ouvrent au contraire sur l’inconnu, sur la promesse d’un accomplissement possible, mais non manifesté. Les fins, interrogatives, renvoient l’auditeur à lui-même. Ce qui se présentait, dans un premier temps, sous forme de mouvements séparés et apparentés, comme dans le Concerto pour alto (1994-1995), s’est inscrit progressivement dans des formes d’un seul tenant, complexes et labyrinthiques : Irrene Stimme (2006), Heur, Leurre, Lueur (2013), Clamour (2014-2015), Eufaunique (2016-2017)...
Dans cette aventure intérieure qui n’a cessé d’être approfondie et qui témoigne d’une grande cohérence, d’une grande fidélité à soi-même, Gervasoni, véritable « poète des sons », a trouvé chez les poètes des mots des alliés substantiels. Sa musique, qui est par essence liée à la voix humaine, s’appuie sur des textes denses, sobres et allusifs qui, tout en saisissant l’émotion à sa source, se réfléchissent et se confrontent aux grandes questions existentielles. Ainsi, aux « chemins qui ne mènent nulle part » de Rilke dans les Due Poesie francesi di Rilke (1995-1996), répondent les questionnements de Silesius dans Dir - in dir : « Où se tient mon séjour ? Où est ma fin ultime à quoi je dois atteindre ? ». Gervasoni n’a pas suivi ses prédécesseurs dans leur travail de déconstruction des textes ; il donne des poèmes, au contraire, une lecture littérale, afin d’en révéler la teneur, incluant même les figuralismes, proche en ce sens d’un compositeur comme Kurtág. C’est ce qui l’a conduit, dans les dernières années, à réinvestir le genre du madrigal, Monteverdi étant par ailleurs pour lui une référence essentielle. Cette alliance du mot et du son révèle le souci d’une musique qui ne soit pas un pur jeu sonore, mais le creuset de significations profondes. Les poètes que Gervasoni a choisis, par-delà la diversité des langues, révèlent les enjeux de sa musique, sa dimension éthique, qu’il s’agisse de Samuel Beckett ou de Nelly Sachs, de José Àngel Valente ou de Gherassim Luca.
« Poétiser le monde », comme le réclamait Novalis, c’est résister à des temps difficiles tout en maintenant ouverte la possibilité d’un réenchantement possible. En se tenant miraculeusement au plus près des sensations premières, où l’émerveillement et la terreur se touchent, Gervasoni a développé et continue de développer une musique sans concession, interrogeant sans relâche la nature et le sens des choses. Dans une époque en pleine régression, ses œuvres constituent un motif d’espérance.